Le film "Fanon" retrace le parcours du psychiatre martiniquais Frantz Fanon depuis sa nomination en 1953 comme chef de service à l'hôpital psychiatrique de Blida en Algérie, jusqu'à son engagement sans faille pour la libération des peuples colonisés. Frantz Fanon a mis en avant les effets psychologiques de la colonisation sur le colon et le colonisé. Son approche novatrice et humaniste de la psychiatrie se heurte rapidement aux méthodes répressives de l’institution coloniale. Peu à peu, son engagement le pousse à prendre position contre le système qu’il sert, pour l'indépendance de l'Algérie. Frantz Fanon va devenir une voix essentielle des luttes anticoloniales.

Amzat Boukari-Yabara est un historien et écrivain. Ses publications portent sur l'histoire contemporaine de l'Afrique et le panafricanisme. Il est l’auteur, notamment, de Africa Unite : une histoire du Panafricanisme, aux éditions La Découverte. Un livre dans lequel il revient sur le parcours de Frantz Fanon. “C’est la première fois qu’il y a une production, comme on dit, grand public, qui a pour objectif de faire découvrir ou redécouvrir Fanon au plus grand nombre. Fanon est un nom qui est très présent dans les imaginaires ou dans les pratiques, pas que militantes. Le film est l’occasion, je pense pour beaucoup, de creuser davantage le personnage, et de découvrir une facette de la guerre d’Algérie qui est assez peu connue. Cette guerre est souvent évoquée sous l’angle des protagonistes français ou algériens, mais là on a le point de vue d’un martiniquais, d’un médecin martiniquais, un psychiatre qui part s’installer en Algérie et qui apporte cette perspective d’un colonisé sur une situation coloniale, qui est celle de l’Algérie”, éclaire Amazat Boukari-Yabara.
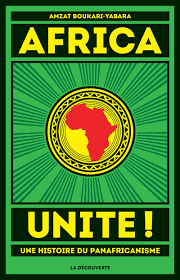
“Un désir de Fanon”
Rapidement après le début de la guerre d'indépendance algérienne en 1954, Frantz Fanon s’engage aux côtés des nationalistes algériens et se rapproche de personnalités du Front de libération nationale (FLN) et sa branche armée, l’Armée de libération nationale (ALN). En 1956, il démissionne de son poste à l’hôpital de Blida-Joinville et déclare renoncer à sa nationalité française. Il est expulsé d’Algérie en 1957.
Frantz Fanon rejoint le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) à Tunis, bras politique du FLN et écrit pour leur journal El Moudjahid, notamment sur la torture. En 1960, il est nommé ambassadeur au Ghana.
C'est une leucémie fulgurante qui l'emporte en décembre 1961, sans qu'il puisse voir l’indépendance de l’Algérie. C’est d’ailleurs en Algérie qu’il est enterré, selon ses souhaits. Il laisse derrière lui des ouvrages majeurs : Peau noire, Masques blancs, Les Damnés de la terre et L’An V de la Révolution algérienne.
“Fanon a pris fait et cause pour l’indépendance de l’Algérie et pour l’unité africaine, en soulignant la nécessité de ne pas encourager les tensions entre les pays africains concernant le besoin d’unité africaine. Il y a aujourd’hui un désir de Fanon, néanmoins il faut faire attention à ce Fanon ne soit pas non plus vidé de sa substance, de sa dimension critique par des approches de récupération politique ou commerciale trop marquées”, conclut Amzat Boukari-Yabara.
Ecoutez Amzat Boukari-Yabara
Envie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nousEnvie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nous






L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.